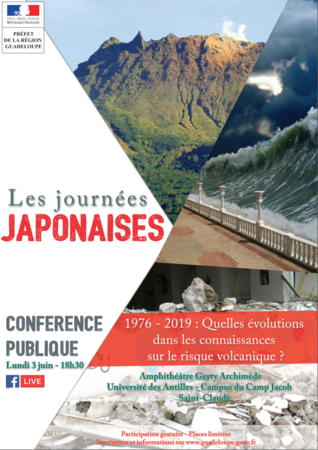Les journées japonaises : qu’est-ce-que c’est ?

La Guadeloupe fait partie des territoires à plus haut risque tellurique de France, avec notamment la proximité de failles et l’existence d’un volcan actif, qui se concrétisent par de multiples séismes annuels, des alertes tsunami récurrentes et une surveillance constante de la Soufrière. Comme nous l’a démontré l’éruption récente de la Soufrière de Saint-Vincent et les Grenadines, le risque volcanique est bel et bien présent dans les Antilles. Il est donc nécessaire que nous ayons conscience de cela, que nous soyons au mieux préparer à l’occurrence d’un tel événement, que nous fassions émerger tous ensemble une véritable culture du risque.
Les origines
C’est précisément pour remplir cet objectif qu’est venue l’idée de dédier, sur le modèle japonais, un temps à l’approfondissement des connaissances sur les phénomènes telluriques. En effet, au Japon, une journée des catastrophes naturelles est organisée annuellement, depuis le dévastateur et meurtrier tremblement de terre du Kanto, le 1er septembre 1923.
Les journées japonaises visent donc à susciter cette attention sur les risques telluriques, à la fois auprès des organismes publics et privés, du milieu scolaire, et du grand public.
L'édition 2023
Le programme de cette édition 2023 des Journées japonaises, spécifiquement dédiée au risque sismique, prévoit un exercice de binômage des communes avec une mobilisation du poste de commandement communal, des actions de sensibilisation en milieu scolaire et en entreprise, ainsi qu’une conférence sur le risque sismique.
Cet exercice s’inscrit dans le cycle des exercices que conduit la préfecture tout au long de l’année : exercice cyclonique, tsunami, pollution marine, plan particulier d’intervention
Le scénario repose cette fois-ci sur la survenue d’une éruption phréatique de la Soufrière.
L’objectif est de consolider la coopération entre les communes directement impactées par une potentielle éruption, et les communes jumelées en charge d’accueillir les populations et les services évacués.
Cette année, 4 communes participent à l’exercice : Saint-Claude, Vieux-Fort, Baie-Mahault et Saint-François. Elles activeront chacune leur Poste de Commandement Communal, diffuseront des alertes à la population et joueront en partie une évacuation sur le terrain.
Retrouvez ci-dessous le dossier de presse et le programme des journées japonaises :

L'édition 2021
Cette année, la crise sanitaire est encore bel et bien présente, mais cette dernière ne doit pas nous empêcher de poursuivre ce travail de sensibilisation aux risques telluriques. En effet, une crise sanitaire n’empêche pas la survenue potentielle d’un séisme, d’un tsunami, ou d’une éruption volcanique. C’est pourquoi cette édition 2021 est totalement dématérialisée.
Elle se focalise plus particulièrement sur le risque volcanique avec des actions à destination du grand public, des publics scolaires et des organismes publics et privés.
Nous vous proposons tout d’abord cet espace dédié aux risques telluriques au sein du site internet de la Préfecture de Guadeloupe. Vous y trouverez de nombreuses informations relatives à ces risques, et des conseils pour vous préparer à la survenue d’un séisme, d’une éruption volcanique, ou d’un tsunami. Nous vous invitons donc, petits et grands, à naviguer sur cet espace.
Aussi, puisque la culture du risque s’apprend dès le plus jeune âge, des actions ludiques de sensibilisation seront menées au sein des écoles maternelles et primaires par les professeurs.
Par ailleurs, des ateliers à destination des collectivités, des partenaires économiques et institutionnels auront lieu. Ils permettront d’aborder des points précis liées à la gestion de crise. Un premier atelier se concentrera sur la phase d’après-crise, et notamment la reprise d’activité socio-professionnelle après une catastrophe naturelle majeure. Un deuxième atelier traitera de la question du jumelage des communes pour faciliter l’évacuation des communes concernées en cas d’éruption volcanique. Un dernier atelier abordera les mesures à prendre en cas de retombées de cendres d’un volcan voisin.
Enfin, puisqu’il faut se former, régulièrement, et aboutir à des gestes réflexes, nous allons réaliser au cours de ces journées un exercice simulant une entrée en éruption de la Soufrière.
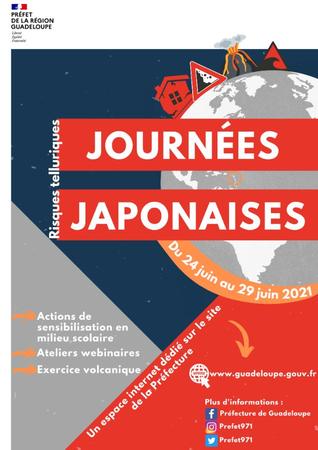
L'édition 2020
Suite à la pandémie de Covid-19, la seconde édition des Journées japonaises n'a pu être organisée comme il se doit. Un exercice sismique a néanmoins été réalisé dans le cadre de la semaine « SISMIK » organisée en novembre 2020.
L'édition 2019
La première édition des Journées japonaises a mis en avant le risque volcanique, avec un programme riche à destination des plus petits et des plus grands.
Notamment, plusieurs ateliers étaient proposés :
-> un premier autour de l’alerte descendante ;
-> nuages de cendres et de leurs conséquences sur l’eau ;
-> puis un dernier atelier sur l’harmonisation des consignes sur le risque sismique.
Une conférence publique sur le thème « 1976-2019, quelles évolutions dans les connaissances sur le risque volcanique ? » a également été organisée.
Enfin, un exercice volcanique s’est tenu en Préfecture, faisant intervenir les acteurs du Centre opérationnel départemental (COD, soit la cellule de crise de la préfecture), ainsi que le poste communal de commandement de la ville de Saint-Claude.